Le jury qui a décidé d'attribuer le Prix National de Littérature 2017 au Dr Luis Álvarez Álvarez a pesé avec précision la qualité, la rigueur et l'originalité de son œuvre littéraire prolifique, forgée dans la persévérance d'études et de recherches approfondies sur les plus divers sujets culturels.
Ceux qui le connaissent, même sans jamais avoir échangé un mot avec lui, se félicitent de la reconnaissance bien méritée et opportune d'un homme dont le prestige et l'autorité dans le monde intellectuel, universitaire et social se sont forgés à force de talent et d'une grande sagesse.
Souffrant ces derniers jours de fortes douleurs à la colonne vertébrale, à la suite d'une chute, Luis a accepté sans aucune hésitation la demande du journal Granma de soutenir une réunion pour parler de lui et profiter un temps raisonnable de son verbe toujours prêt à répondre précisément, sans demi-mesure.
Un de vos contemporains, je fais référence au ministre de la Culture Abel Prieto Jiménez, assure que vous êtes « l'intellectuel le plus cultivé de sa génération ». Qu'est-ce qui passionnait, intéressait ou préoccupait le jeune Luis à l'Université de La Havane ?
La vérité est que moi-même je ne sais pas pourquoi Abel s’est référé de moi ainsi. J'apprécie le compliment, mais heureusement, à cette époque, j'étais comme n'importe quel autre jeune de 20 ans qui étudiait à La Havane. J'ai apprécié ma jeunesse, mais j'ai aussi étudié très dur.
Quand je suis allé m'inscrire, il n'y avait que deux carrières qu'un jeune de Camagüey pouvait étudier: la biochimie et la licence en langues et littératures classiques, c'est-à-dire le latin et le grec. J'ai finalement opté pour cette dernière, car l'important pour moi était que je voulais à tout prix étudier à La Havane.
Ce fut une période difficile dans les années 70 : la bourse, les coupures d’électricité, le travail volontaire, les stages de production, les fonctions d’étudiant assistante et un bref passage à la télévision universitaire qui a beaucoup contribué à ma formation, car la culture c'est ça : la capacité d’évoluer dans différents scénarios.
Plus tard, j'ai passé près de trois ans liés à un projet de recherche sociologique dans l'Escambray, une étape intéressante mais qui m'a séparé de mon rythme normal d'étudiant, ce qui m'a obligé à faire un plus grand effort, car dans de telles conditions, étudier le grec à la lumière d'une lanterne n'était pas une chose facile.
C'est-à-dire qu'au cours de ces années, j'ai été soumis à différents types de pressions qui m'ont fait étudier des choses dissemblables. Aujourd'hui encore, si je dois faire un travail, je fais un effort pour l'apprendre. Je n'aime pas l'improvisation idiote ou flagrante de dire que je sais quelque chose et de ne pas l'être. J'essaie toujours d'être aussi préparé que possible.
Une fois diplômé, vous êtes resté à travailler comme professeur à l'Université de La Havane ?
Pas exactement. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'une carrière assez particulière, dans laquelle j'étais le seul étudiant, ils voulaient que je reste et travaille ici, mais mon stage était dans l'Université de Camagüey.
En fait, cette année-là, un calcul économique a été fait et je me suis avéré être le diplômé le plus cher de l'Université de La Havane, car à partir de la deuxième année, je suis resté seul et tous les professeurs qui, en plus, étaient au plus haut niveau du École de Lettres et, par conséquent, les mieux payés, car ils travaillaient pour moi.
À Camagüey, ma tâche fondamentale était de créer la revue scientifique de l'Université. Je n'y connaissais pas grand-chose, mais j'ai fait quelques recherches et j'ai réussi à sortir deux numéros. Cependant, à un certain moment, j'ai été informée par la Dr Vicentina Antuña que j’avais été transféré dans mon centre d'origine.
Là, pendant environ six ans, j'ai alterné enseignement et travail éditorial, j'ai fini par devenir rédacteur en chef de la revue de l'Université de La Havane, mais cette fois j'ai été formé par Ambrosio Fornet, une véritable autorité dans le domaine de l'édition.
Il était très gentil, car il est arrivé un moment où j'avais tellement de pression et de charge de travail que la fonction d’éditeur, c'est-à-dire la révision des textes proposés pour la revue et les rencontres avec les auteurs, je l’exerçais la nuit et tôt le matin.
A cette époque, j'ai travaillé comme enseignant dans de nombreux endroits en même temps: dans l'Institut Supérieur d'Art, dans la Faculté des langues étrangères et dans l'École d'art et de littérature. D'une certaine manière, j'ai apprécié cette complexité. C'était un défi qu'un jeune de 26-27 ans trouvait agréable et intéressant.
Quelles raisons vous font alors revenir dans votre Camagüey natal ?
Pour une raison très simple : je n'avais pas de maison. J'étais déjà avec ma compagne Olga García Yero, qui n'était pas non plus de La Havane, et à un certain moment, nous avons tous les deux décidé, déjà mariés, que nous n'allions pas continuer dans cette situation, car dans la vie, il faut avoir enfants et vous devez avoir une maison.
C'est alors que nous sommes retournés à Camagüey et avons commencé à travailler à l'Institut Pédagogique Supérieur José Martí. Cela a signifié un changement très fort dans ma vie, car j'ai été obligé de changer de profil : de la philologie classique, c'est-à-dire le latin, le grec et d'autres matières connexes, à la littérature, j'ai dû enseigner la littérature cubaine et universelle.
Cela signifiait que je devais étudier à égalité avec mes élèves et, bien sûr, plus que mes élèves, car le moins qu'un enseignant puisse faire, c'est d'avoir un peu plus de niveau. Je suis donc venu de La Havane à Camagüey pour étudier et acquérir un autre domaine professionnel.
C'est comme ça que j'étais jusqu'en 1992 quand ma femme et moi avons décidé de quitter l'école pédagogique et d’aller travailler dans le secteur de la culture, à une époque où le Centre d'études Nicolás Guillén était en cours de création et, j'y suis allé.
Cela représentait un autre changement de perspective, car la tâche fondamentale de ce centre était d'orienter la recherche culturelle dans la province et c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas.
En d'autres termes, j'ai été obligé d'étudier à nouveau, et je pense avec de bons résultats, car pendant dix ans, le Centre d'études Nicolás Guillén est devenu le centre de recherche le plus réputé du pays, non seulement grâce à mes efforts, mais aussi avec une solide équipe de spécialistes qui se sont pleinement consacrés à ce travail.
En paraphrasant le titre d'un de vos essais, comment faire la culture depuis « l'intérieur » du pays et ne pas mourir en essayant ?
Mon travail dans le Centre Nicolás Guillén, et en général dans la Culture, signifiait de nouveaux défis. Malgré le fait qu'il existe une politique culturelle nationale, il est nécessaire que les régions aient leur propre approche culturelle, leur propre travail culturel, adapté aux possibilités de toutes sortes : artistiques, économiques, institutionnelles...
Il est nécessaire que chaque région du pays génère, pour le dire ainsi, sa propre politique culturelle, bien sûr liée à la politique nationale, car il ne s'agit pas seulement de faire une fête et une pachanga, mais quand c'est réel, cela signifie le développement de potentialités, des talents et des institutions qui existent dans chaque territoire.
En ce sens, c'est un travail très difficile, car il demande, d'une part, une indépendance créative pour pouvoir développer et gérer des lignes de travail et, d'autre part, et c'est le plus difficile, il faut unir les volontés de toutes sortes, non seulement d'artistes et de leaders de la culture, mais parfois aussi d'autres secteurs de la société.
C'était très difficile, mais j'aime les défis. Il faut bien connaître son territoire, ses besoins, ce que les gens veulent recevoir comme culture, qui n’est pas toujours bon, et puis il faut travailler un peu l'interrelation. Tout ceci j'ai aussi dû l’apprendre avec le temps.
Poète, essayiste, critique, pédagogue... dans lequel de ces domaines vous sentez-vous le plus commode ou le plus à l'aise ?
Chaque activité que l'on pratique peut être plus ou moins agréable. Pour ne pas vous laisser sans réponse, je dirais que je trouve angoissant d'écrire de la poésie. Cependant, mon travail d'enseignant, que j'aime beaucoup, est lié à la critique et aux essais, car si vous n'exercez aucune critique sur quoi que ce soit dans votre travail, vous êtes un enseignant nul.
Mais la seule préférence, et jusqu'à présent la vie me l'a plus ou moins permis, c'est de les faire tous en même temps, car l'un soutient l'autre et on se sent vraiment bien dans son travail.
Dans vos essais, vous vous êtes penchés sur la vie et l'œuvre de personnalités dissemblables de l'art et de la littérature. Quelle place occupe José Martí dans vos recherches ?
Je suis venu à Martí par pur hasard. J'étais déjà à Camagüey, à une époque où je venais de terminer mon stage de professeur de philologie classique, et j'ai postulé pour faire un doctorat, ce qui était un objectif habituel et continue de l'être parmi les professeurs d'université.
Au moment où je m'y attendais le moins, ils m'ont appelé pour me dire qu'il avait été approuvé, mais que je devais dire le sujet à étudier. Sans trop y penser, j'ai répondu que je le ferais sur l'oratoire de José Martí, car j'avais besoin d'un sujet qui nécessiterait peu de voyages à La Havane et me permettrait d'avoir la bibliographie de base à portée de main.
Je peux même dire que je n'avais pas lu Martí dans son intégralité et ce que j'avais lu, je l'avais mal fait, sans trop d'effort professionnel. Ce n'était donc pas une vocation, c'était un besoin pratique, pragmatique qui m'a conduit à Martí.
A partir de ce moment, comme c'est naturel dans le cas de Martí, je suis tombé amoureux du sujet et j’y suis resté, ce qui a également signifié un changement pour ma vie, car j'ai été forcé d'entrer dans deux champs concentriques que je n'avais pas transités : la littérature cubaine et plus particulièrement l'œuvre de José Martí.
Vous avez été, dès sa création, le coordinateur de la Maitrise en Culture Latino-américaine. Quelles satisfactions ou déceptions cette responsabilité vous a-t-elle laissées ?
C'était un projet qui m'a apporté d'innombrables satisfactions, car il faut se situer au moment où il se présente : il n'y avait pas de maitrise de profil humaniste à Camagüey, ce qui signifiait que les spécialistes manquaient d'amélioration pour obtenir un diplôme universitaire supérieur.
Quand ça commence, l'inscription initiale était de plus de 100 personnes. Une chose terrifiante, mais je ne voulais pas fermer les portes parce que j'étais conscient de la nécessité pour la province de le faire. Nous avons commencé sans ressources, avec très peu de bibliographie et un petit corps professoral, mais très compétent, combatif et enthousiaste.
C'étaient de merveilleux étudiants, venus d'une douzaine de provinces, qui ont fait un effort formidable. Des spécialistes de diverses sphères y ont convergé. C'était tellement hétérogène qu'un dialogue très intéressant s'est établi, impossible à réaliser quand on a une classe où tout le monde a le même profil.
Ce débat professionnel a donné lieu à d'excellentes thèses pour ce type de programme, dont plusieurs ont remporté des prix nationaux et internationaux, qui ont été publiées sous forme de livres, et d'autres ont abouti à des doctorats. Ce fut une expérience dont je me souviens avec tendresse et avec une affection extraordinaire.
Cependant, le moment est venu où ceci a dû être évalué par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, un processus qui a duré plus d'un an, au terme duquel les spécialistes ont décidé de liquider la maitrise pour des raisons que je considère encore très discutables.
Je pense que c'était une involution schématique et regrettable, car tout ce qui a été fait à Cuba, en termes de formation, l'a été avec un effort énorme. Il faut affronter les défis culturels et scientifiques d'un pays avec la volonté de le faire coûte que coûte.
Parmi tant de récompenses et de reconnaissances que vous avez reçues tout au long de votre carrière intellectuelle, comment appréciez-vous celle décernée par l'Association Hermanos Saíz lorsque vous avez été nommé Enseignant des Jeunes ?
Pour moi, c'était très agréable de recevoir cette distinction. J'ai toujours été intéressé par le dialogue avec les jeunes – étudiants, enseignants, écrivains – non pas pour ce que je peux leur apporter, ce qui n'est pratiquement rien, mais pour ce qu'ils peuvent m'apporter.
Les jeunes apportent toujours le sentiment d'une époque, les besoins d'une certaine époque et bon, quand on vieillit, je me dirige vers les 70 ans, on risque de perdre contact avec la réalité qui nous entoure.
Que représente Olga García Yero dans la vie et l'œuvre de Luis Álvarez Álvarez ?
Elle représente avant tout mon soutien affectif et professionnel. Je lui dois plus à elle qu’elle a moi, car nous nous complétons beaucoup. Olga a fait un diplôme lié à Cuba et son propre intérêt cela l'a amenée à en apprendre beaucoup sur Cuba, alors que mes connaissances professionnelles sur le pays sont pleines de lacunes, non seulement à cause de ma formation initiale, mais parce que je ne suis pas une personne totalement systématique et elle oui.
Mais, bien sûr, ce n'est pas le lien le plus important : c'est le lien absolument personnel, affectif, en tant que couple, en tant que parents, en tant que professionnels qui ont toujours travaillé ensemble. Je ne peux pas imaginer travailler sans elle, ni imaginer la vie, bien sûr, sans elle. Cela n'existe tout simplement pas.
Vous êtes un collaborateur actif de Cubaliteraria, le portail numérique de l'Institut Cubain du Livre. Qu'est-ce que l'entrée dans le monde d'Internet a signifié pour Luis Álvarez ?
Mon entrée à Cubaliteraria a également été fortuite, sur la base d'une très aimable invitation qui m'a été faite par Alpidio Alonso, alors vice-président de l'Institut Cubain du Livre.
C'était entrer dans un monde professionnel lié à mon monde traditionnel, mais différent. Je n'avais jamais été journaliste numérique, car en fait ma fonction là-bas est celle de chroniqueur et de critique, et la vérité est que j'ai beaucoup appris.
J'ai une relation avec ses éditeurs comme il se doit et ce n'est pas toujours atteint ; c'est-à-dire que l'éditeur me demande, me suggère, car j'ai eu la chance que ce soient des gens très professionnels. Je peux vous assurer que je n'ai jamais eu un lien aussi personnel avec un autre éditeur et j'espère pouvoir continuer à le faire encore longtemps.
Quels nouveaux projets vous occupent la plupart de votre temps aujourd'hui ?
En ce moment, je suis assez inquiet, car j'ai deux projets à moitié terminés, tous deux sur José Martí. En fait, ce sont deux livres voués à la publication et que différents problèmes de santé, de travail et de temps m'ont empêché de conclure.
J’en assume un seul et plongeant dans la relation de la pensée de Martí avec la nationalité cubaine et les concepts de nation, de souveraineté et de peuple. L'autre, que je partage avec deux jeunes chercheurs, Sandra González et Alejandro Fernández, est sur le poids de la culture française chez notre Apôtre.
C'est un domaine qui n'a pas été exploré de manière exhaustive et où nous avons trouvé, en particulier mes collègues, des éléments inconnus qui, lorsque nous parviendrons enfin à terminer le livre, vont modifier certaines des perspectives que nous avons sur José Martí.
Par Miguel Febles Hernández

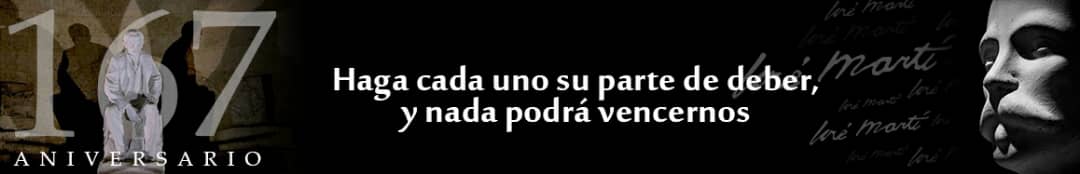



Deje un comentario