Ce nom si beau qui, au bas de ces vers tristes, doux et lumineux, ressemblait bien plus à une invention romantique qu'à un nom véritable, ce nom désormais n'est plus celui d'un vivant. Cet esprit tout de finesse, cette tendance timide et fragile, cette errance idéaliste, cet amour mélancolique pour la beauté absente de sa terre natale, car les lettres n'ont d'autre recours que de se vêtir de deuil ou se prostituer dans un pays privé de liberté, ne sont plus aujourd'hui qu'une poignée de poèmes, imprimés sur un papier misérable, comme le fut, dit-on, l'existence du poète.
De la beauté son âme était éprise ; du cristal taillé et de la légèreté japonaise ; de la couleur de l'absinthe et des roses du jardin ; des femmes parées de perles et d'argent ciselé ; et il pouvait, comme Cellini, faire entrer Jupiter sur une salière. Il avait en horreur la fausseté et l'affectation. Il est mort, de faiblesse physique, ou de l'ennui de vivre, avec son monde imaginaire élégant et sentimental, au milieu d'un peuple servile et contrefait. On peut dire de cet amoureux de l'art que, pour avoir apprécié si intimement celui venu de France, il fut pris par cette poésie sans valeur, empreinte d'un désenchantement factice et inutile, avec laquelle les orfèvres du vers parisien ont occupé ces dernières années le vide des idées de leur époque de transition. Dans le monde, à condition de l'assumer avec dignité, il y a encore de la poésie pour longtemps ; tout dépend du courage moral avec lequel on affrontera et dominera l'injustice apparente de la vie ; aussi longtemps qu'il y aura une bonne action à faire, un droit à défendre, un livre sain et fort à lire, un coin perdu de montagne, une femme vertueuse, un ami véritable, le cœur sensible aura la vigueur nécessaire pour aimer et chanter la beauté de la vie, rendue parfois haïssable par la méchanceté brutale dont l'enlaidissent souvent les rancunes et la cupidité. La marque de la grandeur, c'est cette sorte de victoire. D'Antonio Pérez est cette vérité : « Il n'est que les grands estomacs pour digérer du poison.»
Dans toute notre Amérique, Julián del Casal était très connu et aimé, et déjà se font probablement entendre éloges et lamentations. C'est qu'en Amérique fleurit déjà la nouvelle génération, qui demande du poids à la prose et du caractère au vers, et exige travail et réalité en politique comme en littérature. On est lassé du style ampoulé, et de la politique creuse et rudimentaire, et de cène fallacieuse exubérance des lettres qui fait penser aux chiens soufflés de ce fou de Cervantes. C'est comme une famille en Amérique que cette génération littéraire, qui a débuté par une recherche d'emprunt, et en est maintenant à l'élégance aisée et concise, et à l'expression artistique et sincère, brève et travaillée, du sentiment personnel et du jugement créole et sans détour. Le vers doit, pour ces travailleurs, sonner fort et voler haut. Le vers, fils de l'émotion, doit être fin et profond, comme une note sur la harpe. Ce qu'il faut dire, ce n'est pas l'exceptionnel, mais le moment exceptionnel de l'émotion noble ou charmante. — Et ce vers-là, c'était celui que, avec l'approbation et l'affection des Américains, Julián del Casal élaborait. En outre, il y avait une autre raison pour qu'on l'aimât ; c'est que la poésie plaintive et capricieuse qui lui vint de France avec ses rimes parfaites, finit par être chez lui l'expression naturelle du faible attachement qu'un artiste aussi délicat devait éprouver pour la terre de ses origines, où la conscience secrète ou déclarée de l'humiliation générale fait de tous des désemparés ou des simulateurs, sans force ni goût pour la franchise et les grâces de l'âme. La poésie ne vit pas sans honneur.
Le pauvre poète est mort, et c'est à peine si nous le connaissons. Ainsi en va-t-il de nous tous, sur cette terre infortunée, partagés en deux, avec nos énergies éparses par le monde, vivant sans personnalité dans les pays étrangers, tandis que des étrangers ont pris place dans les fauteuils de notre propre pays ! Nous nous aigrissons au lieu de nous aimer. Nous nous jalousons au lieu d'ouvrir la route ensemble. Nous nous aimons comme au travers des grilles d'une prison. II est temps d'en finir, en vérité ! Julián del Casal en a fini, jeune et malheureux. Ses vers demeurent. L'Amérique l'aime, pour sa finesse et sa sincérité. Et les femmes le pleurent.
(Article paru dans Patria, New York, le 31 octobre 1893)
Traduit par Jean Lamore

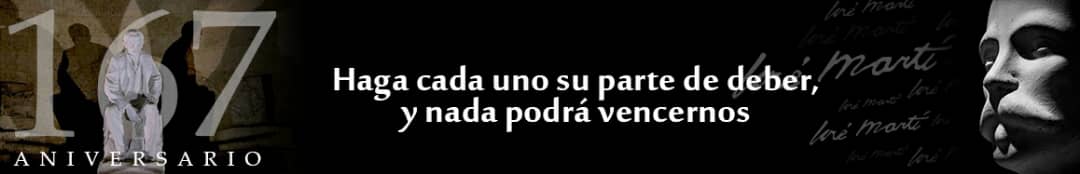



Deje un comentario