Le villageois vaniteux croit que le monde entier est son village, et, pourvu qu’il en reste le maire, ou qu’il mortifie le rival qui lui a chipé sa fiancée[1], ou que ses économies croissent dans sa cagnotte, il tient pour bon l’ordre universel, sans rien savoir des géants qui ont sept lieues à leurs bottes et peuvent lui mettre la botte dessus[2], ni de la mêlée dans le Ciel des comètes qui vont par les airs, endormies, engloutissant des mondes[3]. Ce qu’il reste de village en Amérique doit s’éveiller. Notre époque n’est pas faite pour se coucher le foulard sur la tête, mais les armes en guise d’oreiller, à l’instar des vaillants de Juan de Castellanos[4] : les armes du jugement, qui vainquent les autres. Tranchées d’idées valent mieux que tranchées de pierre.
Nulle proue n’est capable de fendre un nuage d’idées. Une idée énergique, que l’on fait flamboyer à temps à la face du monde, stoppe, telle la bannière mystique du jugement dernier[5], une escadre de cuirassés. Les peuples qui ne se connaissent pas doivent se hâter de se connaître, tels ceux qui vont se battre côte à côte. Ceux qui se montrent les poings, tels des frères jaloux convoitant tous deux la même terre, ou celui à la petite maison enviant celui à la maison meilleure, doivent ajuster, de manière qu’elles ne fassent plus qu’une, leurs deux mains. Ceux qui, à l’abri d’une tradition criminelle[6], ont rapetissé, du sabre rougi du sang de leurs propres veines, la terre du frère vaincu, du frère puni au-delà de ses fautes, s’ils ne veulent pas que le peuple les appelle voleurs[7], qu’ils rendent ses terres au frère[8]. Les dettes d’honneur, l’honnête homme ne se les fait pas rembourser comptant, à tant la gifle. Nous ne pouvons plus être ce peuple de feuilles qui vit au gré de l’air, la cime couverte de fleurs, claquant ou bourdonnant selon que le caprice de la lumière la caresse ou que les tempêtes la fouettent et la ravagent : les arbres doivent se mettre en rang pour que le géant aux sept lieues ne passe pas ! C’est l’heure du dénombrement et de la marche unie, et nous devons aller en carré serré, comme l’argent à la racine des Andes[9].
Les avortons, il ne leur manquera jamais que le courage. Ceux qui n’ont pas foi en leur terre sont des avortons. Parce que le courage leur manque à eux, ils le nient aux autres. Ils ne peuvent atteindre l’arbre difficile de leur bras malingres, de leur bras aux ongles vernis et couverts de bracelets, de leur bras de Madrid ou de Paris, et ils disent qu’il n’y a pas moyen d’atteindre l’arbre. Il faut charger les bateaux de ces insectes nuisibles, qui rongent jusqu’à l’os la patrie qui les nourrit. S’ils sont Parisiens ou Madrilènes, eh bien, qu’ils aillent au Prado[10] faire les farauds, ou qu’ils aillent au Tortoni[11] exhiber leur hauts-de-forme. Ces fils de menuisiers, qui ont honte que leur père soit menuisier ! Ces natifs d’Amérique, qui ont honte, parce qu’elle porte un tablier indien[12], de la mère qui les a élevés et renient, les gredins ! de leur mère malade et l’abandonnent seule sur la couche des maladies ! Dites-moi, qui donc est l’homme : celui qui reste auprès de sa mère pour soigner sa maladie, ou celui qui la met au travail là où on ne la voit pas et vit à ses dépens sur les terres putrides, le ver en guise de cravate, maudissant le sein qui l’a porté, promenant l’écriteau de traître au dos de la casaque de papier[13] ? Ces fils de notre Amérique - celle qui doit se sauver avec ses Indiens[14] et va de moins à plus - ces déserteurs réclamant un fusil dans les armées de l’Amérique du Nord - celle qui noie ses Indiens dans le sang [15] et va de plus à moins ! Ces freluquets, qui sont des hommes et ne veulent pas faire leur ouvrage d’hommes ! Dites-moi, le Washington qui leur a fait cette terre-ci, est-il allé par hasard vivre chez les Anglais, vivre chez les Anglais dans les années où il les voyait se ruer contre sa propre terre ? Ces « incroyables » de l’honneur, qui l’avalent sur les terres étrangères, tout comme les incroyables de la Révolution française, dansant et se pourléchant, avalaient les r[16] !
La Revista Ilustrada de Nueva York, 1er janvier 1891 El Partido Liberal (Mexico), le 30 janvier 1891 Obras Completas, t. 6, pp. 15-23
Notes:
[1] Cintio Vitier (Vida y Obra del Apostol José Martí, La Havane, 2004, Centro de Estudios Martianos, pp. 339-355) offre ce texte - en édition critique - tel que paru d’abord dans La Revista Ilustrada de Nueva York, le 1er janvier 1891 selon la version suivante : « o le mortifiquen al rival” » (« qu’on lui mortifie le rival »).
[2] C’est poser d’entrée le problème central de cet article-manifeste et de l’époque (qui reste celui, encore plus prégnant peut-être, de la nôtre où le rouleau compresseur de la mondialisation néolibérale tend à la pensée unique et au modèle politique unique) : si l’Amérique espagnole veut conserver son visage à soi, son originalité, elle doit cesser de se regarder dans le miroir de modèles politiques, économique et sociaux étrangers, de vouloir les copier et se doter des siens propres ; sinon, elle risque de perdre non seulement ses caractéristiques émanant d’une histoire différente (à cet égard, son grand discours de décembre 1889, « Mère Amérique », utilise une formule lapidaire : « L’Amérique du Nord est née de la charrue ; du mâtin, l’espagnole »), mais encore de se perdre tout court, car un autre danger la menace : les géants aux bottes de sept lieues. L’un des référents les plus fameux de la littérature occidentale est ici, bien entendu, l’ogre du conte de Charles Perrault, « Le Petit Poucet », et c’est bien celui-ci que Martí évoque : si un ogre est par définition « un géant à l’aspect effrayant, se nourrissant de chair humaine », l’image était on ne peut mieux choisie : depuis sa venue au monde en 1783, l’ogre étasunien avait en effet donné des preuves éloquentes de son appétit apparemment insatiable, d’autant qu’à l’instar de celui de Perrault, « il mangeait les petits enfants » et « sentait la chair fraîche ». Fin 189o, sortant de la caverne bornée par les Appalaches, il avait déjà « englouti » une partie de la Floride occidentale (traité de 1795 avec l’Espagne) ; la Louisiane (1803, par achat à la France qui l’avait cédée à l’Espagne en 1763 mais récupérée quarante ans plus tard pour la vendre finalement aux Etats-Unis pour quinze millions de dollars) ; le reste de la Floride occidentale (1810 et 1813, enlevé de force à l’Espagne) ; deux territoires à la frontière Nord-Ouest (cédés par la Grande-Bretagne en 1818) ; la Floride orientale (1819, achetée à l’Espagne) ; puis, une fois conclue l’expansion vers le sud (Floride) et vers l’ouest mitoyen avec le territoire original (Louisiane), un territoire à la frontière Nord-Est (cédé par la Grande-Bretagne en 1842) ; le Texas (enlevé de force au Mexique en 1845) ; l’Oregon (aux dépens de l’Espagne en 1846) ; la Californie et le Nouveau-Mexique (enlevés au Mexique en 1848) ; le territoire de Gadsden (acheté en 1853) ; l’Alaska (acheté à la Russie en 1867). Autrement dit, en moins d’un siècle, l’Union américaine avait conclu son expansion territoriale vers l’Ouest et le Sud, enlevant notamment au Mexique plus de la moitié de son territoire (1 528 241 km2, soit autant que l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse, la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et l’Allemagne réunis !). Quand Martí écrit « Notre Amérique », les Etats-Unis ont convoqué à Washington le congrès « panaméricain » par lequel ils tentent d’imposer leurs vues et conditions aux pays latino-américains. Ses mises en garde angoissées à l’adresse de leurs gouvernements et de leurs peuples au sujet de l’appétit vorace de l’ogre qui « sent la chair fraîche » (la leur) s’expliquent d’eux-mêmes et imprègnent tous ses textes de l’époque. Et la contre-offensive et la prise de conscience sont d’autant plus urgentes que le géant chausse des bottes de sept lieues.
Cintio Vitier (cf. supra) propose deux autres renvois internes : en juillet 1889, Martí adapte pour son premier numéro de La Edad de Oro le conte « Poucinet » d’Edouard Laboulaye (tiré de ses Contes bleus, 1877) sous le titre de « Meñique » où « l’on voit que le savoir vaut mieux que la force » (O.C., t. 18, p. 310), et où Poucinet parvient, entre autres exploits, à faire d’un géant son domestique ; dans sa dernière lettre à Manuel Mercado, écrite la veille de sa mort, Martí écrit son fameux : « J’ai vécu dans le monstre et j’en connais les entrailles. Et ma fronde est celle de David », allusion à l’épisode biblique du jeune berger abattant le terrible Goliath d’une pierre au front.
[3] Dans son article « El hombre antiguo de América y sus artes primitivas » (La América, New York, avril 1884), où il revendique la beauté de l’art des indigènes et se lamente sur le sort qui fut infligé à ces civilisations par le conquérant européen, Martí avait déjà recouru à une image similaire : « Les conquistadores ont dérobé une page à l’Univers ! C’étaient ces peuples-là qui appelaient la Voie lactée "le chemin des âmes" ; pour qui l’Univers était plein du Grand Esprit au sein duquel était enfermée toute lumière, de l’arc-en-ciel couronné d’une sorte de panache, entouré comme des faisans colossaux, des comètes orgueilleuses qui promenaient entre le soleil endormi et la montagne immobile l’esprit des étoiles... » (Obras Completas, t. 8, p. 335 ; cf. Cinto Vitier, Temas Martianos. Segunda Serie, La Havane, 1982, Centre de Estudios Martianos, pp. 136-140.)
[4] Juan de Castellanos (1522-1607).-Né en Espagne, il arrive très jeune en Amérique et après une vie d’aventurier - il est tour à tout soldat, commerçant, pêcheur de perles et prêtre ordonné à Cartagena - il fixe sa résidence à Tunja en 1562, où il est prébendier de l’église de Santiago de Tunja, ce qui lui permet de vivre bien et d’amasser une grosse fortune. S’étant proposé d’écrire une œuvre de littérature historique sur la découverte et la conquête des Antilles et de la Nouvelle-Grenade, et de faire l’éloge des Espagnols y ayant participé, il finit par rédiger aussi l’histoire de ces territoires dans sa monumentale Elegías de varones ilustres de Indias (1589) qui comprend cent treize mille six cent neuf vers hendécasyllabiques, en quatre parties, dont seule la première fut publiée de son vivant.
[5] J’avoue ne pas savoir ni avoir découvert à quoi Martí se réfère ici par cette expression relative au Jugement dernier et donc à l’Apocalypse. Un moteur de recherche sur Internet aussi performant que Google, qui recense aujourd’hui huit milliards de pages, ne renvoie, à l’entrée « bandera mística », qu’à « Notre Amérique » !
[6] J’ignore si Martí fait allusion ici à une tradition historique ou juridique...
[7] Dans sa version critique basée sur La Revista Ilustrada, Cintio Vitier donne la leçon suivante : « ...si no quiere[n] que le[s] llamen el pueblo ladrón... », et explique à la note 5 : « "que les llamen el pueblo ladrón" ; in Obras Completas, t. 6, p. 15 : "que les llame el pueblo ladrones", modification qui change le sens. » Je m’en tiens pour ma part à la version des O.C., car j’avoue ne pas saisir la signification de la leçon de La Revista Ilustrada...
[8] L’épisode qui vient spontanément à l’esprit ici remontait, quand Martí écrivait en 1890, à quelques années à peine : la guerre dite du Pacifique (1879-1883), déclenchée par le Chili, que soutenait la Grande-Bretagne, pour s’emparer des riches gisements de nitrate et de guano alors aux mains de la Bolivie. La guerre opposa le Chili à la Bolivie et au Pérou qui perdirent, celle-là, sa province sur le Pacifique, dont Antofagasta, celui-ci Taracapa, Arica et Tacra, régions riches en nitrate. (En 2006, la perte du débouché bolivien sur le Pacifique continue d’être un très lourd contentieux dans les relations entre les deux pays.) De fait, depuis l’Indépendance, les exemples de guerres fratricides entre pays latino-américains ne manquaient pas, soit pour des raisons économiques soit pour des conquêtes d’espaces, avec, presque toujours en filigrane ou au premier plan, l’action de l’Angleterre et des Etats-Unis qui évacuèrent pendant plus d’un siècle dans les anciennes colonies espagnoles leurs conflits de sphères d’influence. Ainsi, le Brésil, tout juste indépendant du Portugal, et l’Argentine se livrèrent une guerre de trois années (1825-1828) pour la possession de l’Uruguay, que convoitait aussi l’Angleterre et qui se termina sur l’indépendance de l’ancienne Bande orientale. Insatisfaite de l’accord imposé par l’Angleterre, l’Argentine de Rosas tenta d’annexer l’Uruguay en 1839, ce qui provoqua un conflit qui dura jusqu’en 1851 et au cours duquel intervinrent aussi le Brésil, l’Angleterre et la France. La guerre du Paraguay (1864-1870), elle, opposa celui-ci au Brésil, à l’Argentine et à l’Uruguay : elle fut si féroce qu’à sa conclusion, il ne resta plus que 220 000 Paraguayens des 1 337 000 existant en 1864 et à peine 28 746 hommes ! Et le pays y perdit de vastes territoires aux mains du Brésil et de l’Argentine. De son côté, le Brésil eut de fréquentes disputes territoriales avec l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, l’Équateur, la Colombie et le Venezuela. Sans parler des nombreux différends pour cette raison entre les républiques centraméricaines.
[9] Cette image en évoque aussitôt une autre plus tardive, qui apparaît dans sa lettre du 25 mars 1895 à Federico Henríquez y Carvajal, alors qu’il est sur le point de gagner Cuba où la guerre est déjà en cours grâce à lui : « De moi, attendez le renoncement absolu et continuel. Je soulèverai le monde. Mais mon seul désir serait de me coller, là, au dernier tronc, au dernier combattant : mourir en silence. Pour moi, il est temps. Mais je peux encore servir à ce cœur unique de notre Amérique. Les Antilles libres sauveront l’indépendance de notre Amérique et l’honneur déjà douteux et blessé de l’Amérique anglaise, et accélèreront et fixeront peut-être l’équilibre du monde. Voyez un peu ce que nous faisons. Vous, avec vos cheveux blancs juvéniles ; moi, en me traînant, le cœur brisé. // [...] J’obéis - et je dirais même que je l’exécute comme dispense supérieure et comme loi américaine - à la nécessité heureuse de partir, à l’abri de Saint-Domingue, à la guerre de liberté de Cuba. Faisons par-dessus la mer, à force de sang et d’affection, ce que la cordillère de feu andine fait au fond de la mer. » (O.C., t. 4, p. 112.) [10] Le Prado de Madrid. « Philippe IV dote le vieil Alcázar d’une assez noble façade classique, mais ne se préoccupe pas d’articuler le palais à la ville. Au contraire, ce roi galant, plus épris de fêtes et de peinture que de politique, inaugure en 1635 une nouvelle résidence moins maussade : aux confins orientaux de Madrid, près du monastère de San Jerónimo où les rois font retraite, le Retiro, aujourd’hui parc intérieur de Madrid, était un vaste domaine ; un palais, des chapelles, des salles de bal, un théâtre étaient disséminés parmi les arbres, autour du grand étang. De ce fait, entre la ville et le Retiro, les médiocres allées du Prado de San Jerónimo deviennent la promenade à la mode, rendez-vous des oisifs élégants, théâtre des duels, "bourse des amours" ». (Encyclopædia Universalis 2004.)
[11] Martí écrit : o vayan a Tortorni, de sorbetes, faisant un jeu de mots à partir du double sens de sorbete. L’expression, parallèle à la précédente, ne peut signifier dans ce contexte « sorbet », la glace à l’eau, autrement dit « qu’ils aillent manger des sorbets » ou « se ruiner en sorbets », selon les versions de traductions antérieures. Sorbete signifie aussi, dans son acception latino-américaine : « sombrero de copa alta », soit « haut de forme », et désigne donc ici, comme « faraud » antérieurement, une attitude d’imitation présomptueuse de mœurs étrangères.
Tortoni, le plus célèbre des cafés littéraires de Paris. En 1798, un Napolitain du nom de Velloni que les Parisiens appelleront Tortoni ouvrit une boutique de glace à côté du théâtre des Italiens, devenu plus tard l’Opéra Comique ou théâtre Favart, au 22 boulevard des Italiens, au coin de la rue Taitbout. L’immense succès des opéras de Rossini représentés dans ce théâtre attira une foule énorme chez Tortoni dont le café était voisin. Ce succès se confirma avec les concerts de Liszt et Chopin. Le Café Tortoni, remodelé en 1803 avec sa belle terrasse, fut le rendez-vous le plus élégant de l’âge romantique. Honoré de Balzac, Théophile Gautier, Anthony Trollope, Alfred de Musset, Jules Janin, Édouard Manet à ses débuts vinrent y rivaliser d’élégance et d’esprit. Et bien que Tortoni fût décédé en 1822, son successeur continuera à connaître le même succès. C’est à Tortoni que l’on doit la tranche napolitaine, cette crème glacée comportant trois épaisseurs aux parfums différents. Le café Tortoni fut tout aussi florissant sous la Restauration, Louis-Philippe et Napoléon III. Talleyrand, Thiers, M. de Jouy, de Lacrételle, le comte d’Orsay, célèbre par son élégance, le comte de Montrond, un des rois de la mode, le docteur Véron, qui fut directeur de l’Opéra et du Constitutionnel, Alphonse Royer, un des successeurs de l’auteur des Mémoires d’un Bourgeois de Paris à la direction de l’Opéra ; lord Seymour, célèbre par ses excentricités ; Khalil-Bey, plus tard Khalil-Pacha, ministre à Constantinople et ambassadeur de Turquie à Paris ; Gregori Ganesco, qui eut son heure de célébrité sous l’Empire et pendant la présidence de Thiers, fréquentèrent Tortoni. Le prince, alors comte de Bismarck, s’est assis à sa terrasse ; de retour à Paris après vingt-deux ans d’exil, les princes d’Orléans sont allés s’y reposer. Aurélien Scholl, Albert Wolff, Yvan de Woestyne, le peintre Manet, Georges Ebstein, Albéric Second, Adolphe Gaiffe furent des habitués du fameux établissement.
[12] La version d’El Partido Liberal reproduite in O.C. dit : porque llevan delantal indio, soit “parce qu’ils portent un tablier indien », qui semble moins logique que la version de La Revista Ilustrada.
[13] On pense spontanément aux condamnés par l’Inquisition à porter le fameux san-benito, cette casaque jaune en forme de poncho qui les identifiait publiquement à ce titre. Mais il était fait d’étoffe ou de laine, non de papier, le seul élément de cette matière-ci - mais pas forcément toujours présent - étant l’espèce de mitre qui couronnait parfois leur chef, appelée la coroza. Alors ? Où les traîtres devaient-ils porter cette casaque de papier ? Là encore, une recherche par Google interposé ne renvoie qu’au texte de Martí. Voltaire décrit l’habit infamant comme suit : « ...huit jours après ils furent tous deux revêtus d’un san-benito, et on orna leurs têtes de mitres de papier : la mitre et le san-benito de Candide étaient peints de flammes renversées, et de diables qui n’avaient ni queues ni griffes ; mais les diables de Pangloss portaient griffes et queues, et les flammes étaient droites. » (Voltaire, Romans et Contes, Paris, 1966, Garnier-Flammarion, p. 190.)
[14] On retrouve ici, une nouvelle fois, cette inquiétude de Martí pour le sort des autochtones. Il avait écrit en 1884 : « L’Indien qui disparaît en Amérique du Nord, écrasé sous la formidable pression blanche ou dilué dans la race des envahisseurs, constitue en Amérique du Centre ou du Sud un facteur constant, en faveur duquel on fait bien peu, sur lequel on n’a pas encore voulu compter et sans lequel on ne pourra, du moins dans certains pays, rien faire. Soit on fait avancer l’Indien soit son poids empêchera la marche. / L’Indien est sensé, imaginatif, intelligent, prêt par nature à l’élégance et à la culture. » (« Arte aborigen », La América, New York, janvier 1884, O.C., t. 8, p. 329.) Ou encore : « Qu’importe que nous soyons issus de parents au sang maure et au teint blanc ? L’esprit des hommes flotte au-dessus de la terre où ils ont vécu, et on le respire. L’on est issu de pères de Valence et de mères des Canaries, et l’on sent couler dans ses veines le sang échauffé de Tamanaco et de Paracamoni, et l’on voit comme sien celui que versèrent dans les défilés du mont Calvaire, poitrine à poitrine avec les gonzalves à l’armure de fer, les Caracas héroïque et nus ! Il est bon de percer des canaux, de semer des écoles, de créer des lignes de vapeur, de se hisser à la hauteur de son époque, d’être du côté de l’avant-garde dans la belle marche humaine, mais il est bon aussi, pour ne pas s’évanouir en cours de route faute d’esprit ou par étalage de faux esprit, de s’alimenter, grâce au souvenir et à l’admiration, grâce à l’étude justicière et à l’amoureuse compassion, de cet esprit fervent de la Nature où l’on naît, accru et avivé par celui des hommes de toutes races qui en sont issus et s’y ensevelissent. La politique et la littérature ne prospèrent que lorsqu’elles sont directes. L’intelligence américaine est un panache indigène. Ne voit-on pas comment, du même coup qu’on paralysa l’Indien, on paralysa l’Amérique ? Et tant qu’on ne fera pas marcher l’Indien, l’Amérique ne commencera pas à bien marcher. » (« Autores americanos aborígenes », La América, New York, avril 1884, O.C., t. 8, pp. 336-337.)
[15] Martí avait consacré une chronique entière, en octobre 1885, au « problème indien » des USA, à propos d’une réunion d’ « amis des Indiens, pour traiter en paix de la manière de les attirer à une vie intelligente et pacifique où, à la différence d’aujourd’hui, on ne se moquerait pas de leurs droits, on n’abuserait pas de leur bonne foi, on ne corromprait pas leur caractère, où ils n’auraient pas à juste titre à se rebeller si souvent. [...] ...Le congrès... savait aussi que l’Indien n’est pas ainsi au naturel, mais qu’il est devenu ainsi à cause du système de fainéantise et d’avilissement où on le maintient depuis cent ans. / Là où l’Indien est parvenu à se défendre avec plus de bonheur et rester comme il était, on constate qu’il est de race, fort d’esprit et de volonté, courageux, hospitalier, digne » Il faudrait lire cette chronique entière tant elle est transie de douleur face à la situation dans laquelle les Indiens sont tombés à cause du système de réserves : « Réduit ensuite - pauvre peuple de trois cent mille sauvages dispersés que lutte sans trêve contre une nation de cinquante millions d’hommes ! [...] L’Indien est mort à cause de ce système vil qui éteint sa personnalité : l’homme grandit par l’exercice de lui-même... Un sentiment de férocité abattue que ne s’éteint jamais entièrement chez les races esclaves, le souvenir des foyers perdus, le conseil des anciens qui ont vu dans les forêts natives des époques plus libres, la présence d’eux-mêmes, incarcérés, vilipendés et oisifs, éclatent par vagues intermittentes chaque fois que la rapacité ou la dureté des agents du gouvernement réduit ou refuse aux Indiens les bénéfices stipulés dans les traités ; et comme, du fait de ceux-ci, et uniquement vis-à-vis d’eux, ce que l’homme a de noble leur est interdit et qu’il ne leur est permis que ce qu’il a de bête, il advient naturellement que prévaut dans ces révoltes, défigurant la justice qui les provoque, la bête que le système a développée. / Tout homme esclave est ainsi. Pas seulement l’Indien. [...] Sans travail, sans biens, sans espoir, sans la terre natale, sans d’autres jouissances de famille que les jouissances purement physiques, que peuvent être les Indiens des réductions, sinon des hommes grossiers, paresseux et sensuels, nés de pères qui ont déjà vu leurs pères, la pipe et l’âme éteintes, pleurer accroupis par terre sur la nation perdue, sur l’ombre du grand arbre qui a présidé siècle après siècle leurs mariages, leurs justices, leurs réjouissances et leur conseils ? Un esclave est très triste à voir ; mais encore plus triste un fils d’esclave : jusque dans la couleur on lui voit des reflets de bourbe ! Ces réductions d’Indiens sont de grands élevages d’hommes. Il aurait mieux valu les faucher à la racine plutôt que de les avilir. » (« Los Indios en los Estados Unidos », 25 octobre 1885, O.C., t. 10, pp. 322-325.)
[16] « Dans ce monde bourgeois du Directoire, deux traits sont à noter. C’est d’abord l’ascension d’une petite bourgeoisie issue des artisans ou des commerçants. Enrichis par les affaires, ils achètent des biens nationaux et font donner à leurs enfants une éducation qui leur permettra de devenir fonctionnaires ou - mieux - de s’orienter vers les professions libérales. C’est aussi l’apparition, non d’une classe, mais d’un milieu : les « nouveaux riches », qui ont fait une rapide fortune par des moyens plus ou moins honnêtes. Tels les fournisseurs aux armées, souvent groupés en compagnies : Hainguerlot, Rochefort, Flachat, Ouvrard. L’ "immoralité" du Directoire est celle de ces nouveaux riches et de leurs protecteurs politiques, Barras et Talleyrand ; ses ridicules aussi : "merveilleuses" et "incroyables" tiennent plus ou moins à ces milieux où la richesse s’allie volontiers à la liberté de mœurs et à l’excentricité de la tenue. » (Encyclopædia Universalis 2004.)
Traduit et annoté par Jacques-François Bonaldi

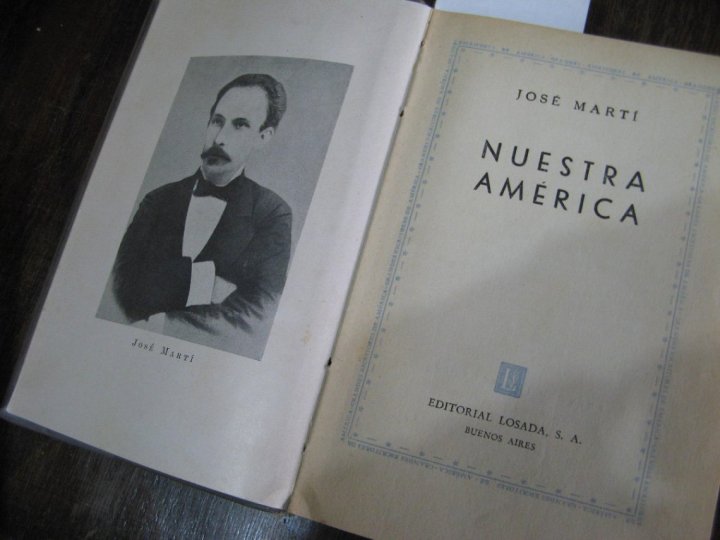
Deje un comentario